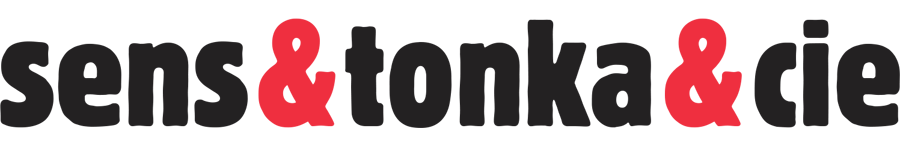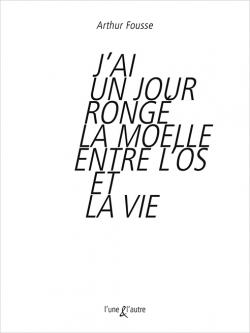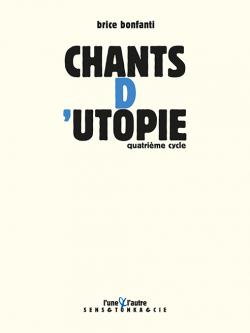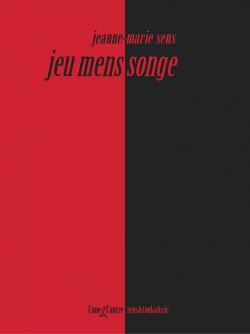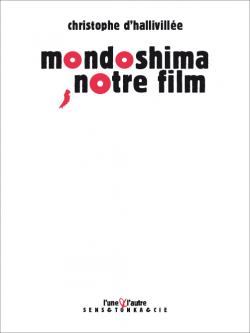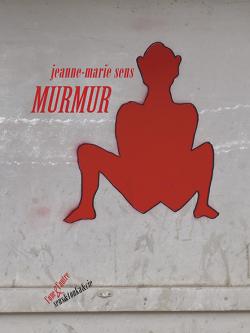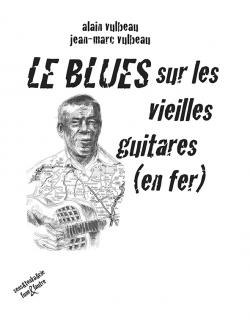L'Une & L'Autre
J’ai un jour rongé la moelle entre l’os et la vie
Le texte se présente comme un oratorio imprécatoire. D’un style à l’éloquence invocatoire aux engagements sataniques dans son propos, il engage un chemin dans la parole excessive, impraticable autour de Francis Bacon. Il s’affirme comme un texte « précaire » : une prière au sens latin, qui a vocation à agir comme une offrande mystique dans un cadre rituel, celui de l’élocution poétique : celle de la perte du langage dans la langue, de la perte de la langue dans la voix. La ritualisation prophétisée à l’excès dans une prosodie rythmée jusqu’à l’hallucinatoire, revendique une filiation entre l’engagement mythique des Aztèques pour le sacrifice humain et la réhabilitation du 5e soleil, marquant la fin apocalyptique de la régénération cosmique. Francis Bacon, institution apocalyptique, joue comme soleil à l’époque contemporaine. Francis Bacon s’avère le seul à pouvoir traduire et manifester le sens extrême d’une telle précaution rituelle et oratoire, sans faire tourner la ritualisation à un exutoire superficiel. Le texte restaure l’ambivalence de l’extorsion du cœur à l’esclave qu’est l’auteur, qui est, aussi, le Maître du sacrifice une soustraction incessante de la Parole au mot. Il engage un sens forcené, une vision qui s’avère ésotérique, permettant de rendre la violence de la parole au langage.
Chant d’utopie
Imaginée en 2001, l’écriture des Chants d’utopie commencée continue.
Ces minuscules épopées en prose et vers, ou prose ou vers, cherchent toujours une étincelle qui annule les ténèbres, ce qui, sans lieu, irrigue tous les lieux, l’utopie !
Neuf cycles de neuf chants sont annoncés. Trois premiers cycles ont paru.
Voici le quatrième.
La suite donc – mais une mer l'a changée. Après une décennie et demie au pied des monts retour occitan à Notre Mer méditerranéenne.
Les chants qui y sont nés sont nés marins, poissonneux, salins. Ainsi le chant du Sahara, et même le chant d’Iraq. On ne sait pas ce qui se trame, dans Notre Mer.
La poésie de Notre Mer est dégagée, embrasse les contraires, vus, sus et lus, complémentaires, dans la mer à ressac et à sac.
Dans ce cycle nouveau, on lira les effets de cette reformulation marine du terrain, des champs d’utopie, de ses prairies.
On croisera l’épique affrontement au Pérou des enfants paysans Micaela et Túpac contre un nécrotératoplasme extraterrestre aussi terrorisant que dégoûtant. Depuis le pays Dogon, l’exploration en cosmonef d’exoplanètes par une grande mère, Innekuzu, dont la vieillesse remonte en jeunesse. La musique néoplatonicienne d’Hypatia d’Alexandrie, hors mélodrames moraleriserinés et sentimentalinassés des hominidés. L’amour interne à toutes et au-delà de toutes religions, proclamé doucement par Kabîr, tisserand à Vārānasī. La tranquillité totale, engagée dans le dégagement total, des moines sangliers, singuliers frères d'Athanase au mont Athos, au milieu du déluge mondial en fin de cycle. Le paradis du jardin perse, dans l’Iran, des enfants de Zarathoustra, légers comme un babil de la première langue. La nuit érotique et alchimique de Zosimos et Myriam à Panopolis. L’action invisible des poissons sarhaouis sur la main de Meriem au Sahara, désert fait mer. La flamme folle amoureuse de Rabi’a en Iraq.
Et toutes ces figures du divers ethnosphérique, le divers salutaire des ethnies toilant la sphère, issues de notre histoire, découvrent hors du temps l’Or du temps, se trouvent toutes dans leur Utopie qui est à tous et à personne.
Têtes de bois
PHOTOGRAPHIES
Paysage, beauté, grandeur et liberté, bois et forêts entourés de plaines solitaires,
plantations diverses, selon le lieu et le climat, parures de villes et de villages.
Atmosphère...
- Ils sont beaux quand on leur permet de respirer et d'exister -
dédales aux cloisons d'air et de temps
L’exercice de l’autobiographie comporte une limite fatale :
il lui manquera toujours le dernier chapitre, la page ultime, l’épilogue que son auteur n’aura pu écrire.
Prenant acte de ce manque structurant non moins que structurel, l’auteur de Dédale aux cloisons d’air et de temps
a tenté de le pallier en dressant en quelque sorte un État des lieux à l’instant où prend fin son récit, ouvrant ainsi en guise de conclusion
une parenthèse que rien ne viendra refermer.
jeu mens songe
JEU MENS SONGE
Un titre insolite qui cache son jeu.
Un titre pour rire. Un titre pour déplorer.
Rouge et noir. Et l’épanchement des mots voués au principe du courant des bases tendres ou cruelles de la vie.
Un double jeu d’écriture, en consonance des mots.
MONDOSHIMA, NOTRE FILM
MONDOSHIMA, NOTRE FILM se présente comme un texte qui a la forme d’un scénario, mais qui n’en est pas un. Il relate une histoire d’amour flamboyante entre deux êtres égarés dans un Hiroshima désormais étendu au monde entier, Mondoshima.
Une fille, rendue amnésique par le traumatisme de l’Explosion du monde, cherche à se rappeler son premier amour. Un garçon qui, par passion pour elle, l’aide à reconstruire la mémoire de cet amour d’avant la catastrophe de Mondoshima.
Ils parlent de l’impuissance de la mémoire à protéger du désastre, de leur désir de tourner ensemble un film qui rende compte de leur amour absolu né après l’Explosion de Monde. Ils citent et détournent Hiroshima, mon amour d’Alain Resnais et Le Mépris de Jean-Luc Godard avec les yeux de ceux qui déjà vivent par-delà le genre et la race. Ils n’ont d’autre principe que de croire à une puissance de l’Amour absolu apte à s’autoriser une bifurcation, quand plus rien ne paraît possible pour stopper l’inexorable marche du monde vers la guerre, vers son extinction.
En librairie le 16 janvier 2024
Reflets
« Reflets est un récit photographique qui aborde, teintée parfois d’ironie, l’actualité comportementale de notre société. Société de consommation excessive, laquelle en grande partie fixée au courant du consommable, instaure un large espace de rentabilité basé sur un système de production souvent fort contestable tant en sa démarche qu’en sa qualité.
Effet miroir.
Dehors dedans. Mise en scène au parfum parfois métaphorique pour une autre dimension où se croisent dans le courant de certaines fonctions des modes, la nature, la misère et la beauté.
Reflets de notre modernité en tous ses états. »
Jeanne-Marie Sens
JOURNAL EN SOUFFRANCE
“ On ne meurt pas d’être malade,
on meurt d’être vivant.”
Montaigne
Atteint d’une sévère maladie accordant peu de place à l’espoir d’une guérison, Yves Lecanuet, en toute conscience de son état, bien au-delà de quelques rémissions, tient minutieusement le journal de ce qui sera, ombré d’inquiétude et d’incertitude, l’ultime étape de sa vie.
Du 4 septembre 2020 au 8 mars 2021 il note toute intervention d’ordre médical au long de ses aller-retours hospitaliers – et jusqu’à son maintien, entre lesquels, sans jamais se départir des douleurs et de la souffrance du corps et de l’esprit, seront convoqués, mêlés au courant des paroles de l’ordinarité, pensées philosophiques et poétiques au parcours éphémère d’un temps retrouvé.
Journal en souffrance s’élabore au fait d’une écriture pressante en sa volonté d’établir un tressage en tout point convenant sur le fil fragile d’un souffle qui s’éteint.
Vestiges et temporalités traversés en références philosophiques et pensées poétiques d’une poignante réalité.
MURMUR
" Tournant les pages du passé, l’espace mural, sur le temps auto programmé écritoire public tout niveau s’ouvrant à toute opportunité ou importunité, prend la parole : chassé-croisé intergénérationnel aux multiples langages, aménité/causticité.
À ce point devenu un espace qui pour autant de moins en moins ne se contient, le champ d’expression s’emballe et gagne du terrain; le squat est d’importance et s’empare sans ambages de tout support urbain de verticalité et d’horizontalité toujours plus à même de jouer à volonté sur tous les tableaux.
Variations choisies, au sens que l’on veut bien leur accorder, sur ce que sont d’autorité les murs d’aujourd’hui.
L’inscription enchaîne.
Beauté. Haine. Agrément. Vulgarité.
Atout venant, et son contraire."
LE BLUES SUR LES VIEILLES GUITARES (EN FER)
" J’ai rencontré le bluesman Willie Casey à Huttington, petite ville de Long Island (État de New York) à propos d’un article universitaire. Notre rendez-vous eut lieu le 10 avril 2016 au domicile de Peter, un ami.
Né le 18 août 1916, ce vieux guitariste de blues était alors presque centenaire. Répertorié dans les ouvrages spécialisés sous le pseudonyme de Chuck Flap, il s’était fait connaître sous le nom de Willie Chuck Flap Casey. Le contact a très vite été confiant, et d’autant plus après lui avoir révélé que je jouais du blues sur une Dobro D33, guitare avec une caisse en métal, identique à celle dont il se servait en fin de carrière.
À mon retour en France, au vu de tout ce que Chuck Flap m’avait révélé mon projet a pris forme et j’en ai discuté avec mon frère Jean-Marc, graphiste et connaisseur sensible de cette culture blues. Nous avons en accord décidé de transformer l’interview en récit graphique, en nous répartissant les rôles : Il prenait en charge les images, j’y adaptais le texte. Un nouveau titre s’est imposé pour une publication qui raconte le blues, notre blues. "